04 septembre 2021
La chaise de Van Gogh dans la revue Europe
Un grand merci à Michel Ménaché pour son bel article
paru dans le dernier numéro de la revue Europe consacré à Monsieur Vialatte!
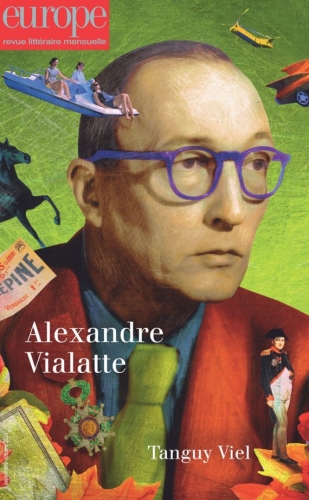
Quelques années après la mort de Lino, son père, Paola Pigani lui rend un hommage sensible, d’une grande délicatesse. La chaise de Lino, à l’abandon dans un hangar, lui rappelle aussitôt celle de Van Gogh peinte sur la toile représentant la chambre n° 5 de l’auberge d’Auvers-sur-Oise. Le rapprochement pourrait paraître insolite mais tant de signes de l’un font écho au parcours de l’autre, des ciels d’exil à la couleur des blés : « le rire est ta paille / il vient du soleil récolté, / ta litière où tu laisses la fatigue / des jours heureux. »
Originaire de Trieste, le jeune Lino combat aux côtés des partisans. Captif des Oustachis -mercenaires des nazis-, jusqu’à leur défaite, la misère et la tuberculose le conduisent d’abord au sanatorium. Plus tard, de Wallonie en Charente où il deviendra paysan-ferrailleur : « Aller par les champs pour Vincent. / Aller aux champs pour Lino. / […] Une force solaire vous soulève le cœur. » Pour payer ses dettes Lino, récupère le cuivre des chutes de câbles électriques. Il les rassemble en « fagots ». « Rouille et rebuts du temps perdu. / Ferrailleur orpailleur, tu es. » Alchimie à main nue, Lino sait « changer le cuivre en terre » ! La propriété des Cosses est ingrate mais l’ardeur au travail est partagée par toute la famille -de cinq enfants-. Il faut débarrasser la terre de son excédent résurgent de pierres : « On va aux cailloux. […] Il faudra retourner aux cailloux. » Le langage du père, « paysan-ferrailleur-rieur », est mimé. Connivence joyeuse : « Tes mains parlent. Tes mais se taisent. / Tu sers le rire. » Les Cosses, c’est encore l’exil à l’étroit : « Notre ailleurs tient tout entier / dans le noir des bois. » Quand Paola atteint l’âge de partir, Lino rafistole la poignée de la vieille valise : « Je suis la fille de mon père. » Et quand la vie de Lino, à empoigner chaque jour, « le courage de l’aube », s’achève, la ferme change de mains, vendue à des Anglais qui lui donnent les couleurs d’une résidence campagnarde. C’en est fini des Cosses, des cailloux, de la sueur et des rires ! Nostalgie et tendresse.
Comme Vincent, Lino est enseveli en terre de France : « Mourir en France. Vos baisers à la terre. / La vie plantée là, même à l’envers. » Reste la chaise vide. Et ce magnifique poème d’amour filial qui exprime si justement ce que du vivant de Lino, Paola Pigani n’aurait osé ou su lui dire : « Que suffise le ciel sur tant de douleur et de beauté. »
Paola Pigani : La chaise de Van Gogh
Editions La Boucherie littéraire
Michel MÉNACHÉ
21:15 Écrit par Paola Pigani dans La chaise de Van Gogh, Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paola pigani : la chaise de van gogh editions la boucherie litt, revue europe, michel ménaché
11 juin 2020
La renouée aux oiseaux dans la revue Europe
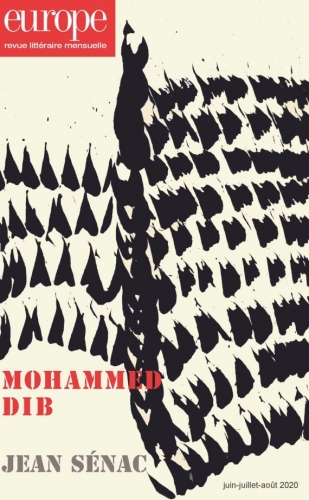
Quatrième recueil de Paola Pigani, La renouée aux oiseaux évoque la tragédie intime de la perte d’un enfant mort-né. L’épreuve bascule dans un asile où la locutrice a été momentanément enfermée, suite au traumatisme. Le réalisme merveilleux et la réalité brutale se conjuguent dans ce recueil bouleversant, de la blessure à jamais ouverte dans le « ventre de pierre » au « seul oiseau […] entré par la blessure ». Le ton est juste, sensible et fort du premier vers jusqu’à l’ultime poème du livre.
Un sentiment de culpabilité agite la jeune mère éperdue qui vit sa souffrance en osmose avec tous les éléments qu’elle touche : « les mains / qui ont tenu l’enfant » : « ces mains de honte / je les enfonce dans la blessure du bois ». Toutes les sensations sont transfigurées en épreuves insoutenables : « il neige du sel sur ma langue / quand je crie la nuit ». Le rapport aux autres et à la nature passe par la métaphore de l’arbre blessé : « je cherche dans les autres / des yeux de sève // […] c’est l’arbre qui garde mes eaux // ses entailles sont les miennes ». Le corps est encore perçu comme enlisé et saturé de ruines : « La ville est dans mon sang / avec ses éboulis / ses canaux qui débordent ».
Les images désignant ou évoquant l’enfant sont associées à l’obscurité, « le petit corps d’os et de ténèbres » s’est perdu dans le néant absolu : « Où es-tu / mon enfant de bois mort ». Mais pour refuser l’évidence, l’instinct maternel, l’infinie tendresse survivent à la détresse. Comme si la mère elle-même disparaissait dans le deuil : « laisser l’enfant dormir / […] le poser sur un limon très doux / qu’il tète en paix / mon absence ». L’hiver lui-même s’humanise et s’adoucit pour caresser l’enfant : « sa première neige / c’est le baiser de l’eau et de l’air ». Mais le corps nourricier est devenu stérile, figé dans le désespoir : « je garde une pierre dans chaque sein ». Le rapport au réel a perdu toute mesure : « Mon arbre a l’épaisseur du monde ».
L’atmosphère de l’asile est délétère : « les voleuses de jardin » qui ont faim sont sous haute surveillance : « Dans la galerie des femmes / je marche à pas de louve tarie ». La violence des soins est décrite comme le châtiment, la censure de toute plainte : « On m’arrache encore la chasuble / on me pousse dans l’eau / qui apprend à se taire ». Dans les travaux collectifs, le corps s’abandonne, s’épuise, se dissout : « Les jours de lessive / mon corps s’égoutte / pendant des heures », jusqu’à « disparaître dans l’eau sale ». L’organisation de l’asile est sélective : « on m’a classée dans les calmes ». Mais tout ici mène à la déshumanisation, à la perte de toute estime de soi : « on ne pense plus / on prie / on s’enguenille ».
Enfin, la perte de l’enfant est aussi vécue comme l’échec du couple : « L’homme d’avant / d’avant la mort / je ne l’ai pas fait père / je l’ai fait taire ». Jusqu’à l’autodestruction charnelle et affective : « je me suis fait terre ». Ce texte sobrement lyrique culmine sur la très belle image végétale de « la renouée aux oiseaux » qui, comme l’ensemble du recueil, transcende le deuil intime par le poème…
Paola PIGANI : La renouée aux oiseaux
(Éditions La boucherie littéraire, collection La feuille et le fusil, 20 €)
Michel MÉNACHÉ
Un grand merci à Michel Ménaché!
12:50 Écrit par Paola Pigani dans La renouée aux oiseaux | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paola pigani , la renouée aux oiseaux, Éditions la boucherie littéraire, revue europe, michel menaché
30 mars 2014
Indovina
Paola PIGANI : Indovina suivi de Ailleurs naît si vite
Editions La Passe du vent – 10 €
Remarquée par son roman N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures (éd. Liana Levi, 2013), Paola Pigani publie un premier recueil de poèmes sous le signe de la révolte, Indovina, (l’) indignée ! Petites scènes de rue, instantanés urbains quotidiens, choses vues ici ou là se succèdent et composent une chronique de la difficulté d’être, d’aimer et de survivre, dans une société qui doute de ses valeurs, marginalise, exclut, brutalise les plus démunis, se détourne de ce qui dérange, se défie de l’altérité. Ce n’est ni sur le mode de la compassion ni sur celui de la rhétorique démonstrative qu’elle témoigne mais avec son regard et sa parole fraternelle de poète, s’attachant à décrypter les signes furtifs et les gestes infimes du vivant. C’est donc au présent que s’ouvre ce recueil : « Je suis née aujourd’hui / J’ai l’âge de la lumière. »
L’auteure dit d’abord son rapport fusionnel au monde des grandes cités, de Lyon à New York, Rome et Venise. Elle énonce ses émotions, sans nostalgie ni vague à l’âme, plutôt avec une sensualité ardente : « J’embrasse le fleuve / Qui court sur l’échine de la ville / Je quitte les berges / Je suis l’onde des rues... » Le regard sur la réalité abrupte n’édulcore rien, va droit au point de rupture, à la violence de l’asservissement social : « Tes yeux s’enfoncent là où / L’ouvrier turc casse l’asphalte / Au marteau piqueur... » Quant aux déracinés perpétuels, les migrants sans droit d’asile, leur évocation prend parfois des accents baudelairiens : « Regards bleus noirs / Grands corps ballants / Marcheurs à contretemps / Dans les vêpres urbaines / Ils sont là / pour larder le visage de la ville / N’ont que leurs ombres à rassembler / Fripés d’un soleil inconsolable / Nous mendions à les voir / Des réponses à nos obscurités. » Une vision sordide, répugnante, paradoxalement s’humanise, antidote à l’indifférence qui stérilise les âmes, assèche les cœurs : « Immobile sous l’orage [...] la pluie lui fait un visage d’acteur américain / Son t-shirt jaune est trempé / Ses épaules tremblent / Ses jambes aussi / d’où s’écoule une rivière de merde /Il est grand il est seul / Avenue Jean-Jaurès / En composant le 112 / il y a toujours moyen de faire ramasser / un ange déchu / sur le lisier d’une ville. » Rédemption du réel insoutenable par le poème !
L’amour se joue dans l’écriture sur des ellipses, avec crudité et délicatesse, toujours avec la justesse et la vérité des sentiments : « Je voudrais te lire / entre mes lignes / sentir tes silences / dans mes poches et ton corps / pour écraser ce temps... » Les images dans leur sobriété picturale confèrent à certains poèmes une tonalité érotique gourmande, voire solaire : « A bout de blanc / A bout de bleu // L’été s’écrase contre nos corps // seuls nos baisers de houblon / nous donnent une idée de la faim. » Paola Pigani tresse aussi le grand corps des villes aux corps amoureux qui s’étreignent : « L’espace mourra entre nos corps / mordus dans l’ivresse / il y aura des ponts à traverser / des iles oubliées en plein fatras de la ville. »
La voix singulière de Paola Pigani est de celles qui s’imposent à la première lecture...
Michel MÉNACHÉ
A paraître dans la revue Coup de Soleil- Maison de la poésie d'Annecy
09:00 Écrit par Paola Pigani dans Des livres, Poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : indovina, la passe du vent, michel ménaché, revue coup de soleil

















